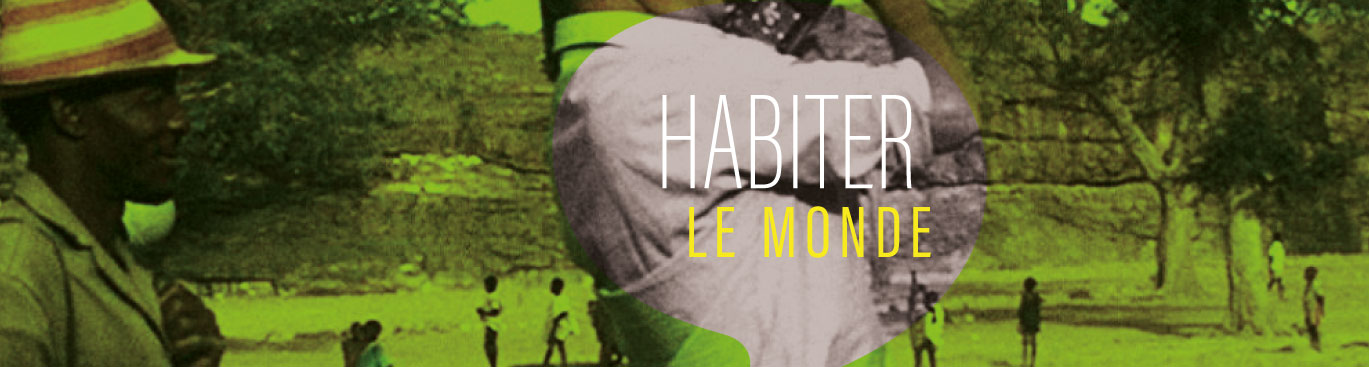Céline Rosselin-Bareille est professeure d’anthropologie (20 ème section) à l’Université de Picardie Jules Verne depuis 2023.
J’ai obtenu mon Doctorat en Anthropologie à l’Université de Paris V – René Descartes, en 1998, en présentant un mémoire sur les espaces habités : « Habiter une pièce. Une ethnographie des espaces par la culture matérielle » (sous la direction de J.-P. Warnier). Cette thèse interrogeait la possibilité même d’« habiter » un espace de transition, provisoire et les dimensions normatives associées.
Mon travail s’inscrivait dans les réflexions d’un groupe de recherche sur la culture matérielle, le MàP (Matière à Penser), que j’ai co-fondé avec Marie-Pierre Julien et Jean-Pierre Warnier, en 1994 au sein du laboratoire de Paris V. Les premiers travaux du groupe ont été consacrés aux processus d’authentification des marchandises puis aux corps-à-corps avec les objets.
J’ai été recrutée en 1999 à l’Université d’Orléans en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (Staps) où j’ai été Maîtresse de conférences en anthropologie sociale jusqu’en 2023.
En 2021, j’ai présenté une Habilitation à Diriger des thèses « De la culture matérielle aux matières à former : rencontres des matières et construction des sujets » (Université de Toulouse Jean Jaurès, LISST-CAS ; Garant : Nicolas Adell). En 2023, j’ai été nommée professeure à l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens et rattachée à l’équipe Habiter le Monde UR4287.
Mes travaux de recherche interrogent la façon dont la culture matérielle (techniques comprise)
articule construction des sujets et fabrication du monde, en s’intéressant aux corps, aux processus vitaux, aux sensorialités engagés notamment dans des situations d’hostilité. J’ai ainsi travaillé sur les scaphandriers travaux publics, de leur formation au travail en chantier, entre 2011 et 2018 (voir projet plus loin). Mes recherches me conduisent également à interroger les frontières de la discipline à travers des dialogues pluridisciplinaires (sociologie, géographie, psychologie, neurosciences).
Dans un dialogue entamé de longue date avec des collègues sociologues et socio-anthropologues des techniques, j’ai également été chercheuse au CETCOPRA (Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2015-2023) et suis membre du Bureau du Groupe de Travail 01 (Corps, Sciences, Techniques et Société) de l’AISLF (Association Internationale de Sociologie de Langue Française), membre du comité de rédaction de la revue Socio-anthropologie (depuis 2021) et co-responsable avec Caroline Moricot d’un séminaire « Mondes hostiles et couplages à la technique ».
A l’échelle de la discipline, je m’intéresse particulièrement aux différents métiers de l’anthropologie.
Ainsi, en tant que membre du bureau de l’AFEA (Association Française d’Ethnologie et
d’Anthropologie) à sa création en 2009 et membre de son CA depuis 2019, j’anime une commission sur le sujet. J’ai co-conçu le prix de thèse Tillion-Rivière (Ministère de la Culture – AFEA) qui récompense des recherches impliquées et participatives. Dans ce contexte, je me suis rapprochée de l’Association Germaine Tillion.
Je participe à un groupe de réflexion d’enseignantes-chercheuses et d’enseignants-chercheurs sur les formations en anthropologie.
Enfin, j’ai été membre élue au Comité National de la Recherche Scientifique (section 38 :
Anthropologie et étude comparative des sociétés contemporaines) pour les années 2021, 2022 et
2023.