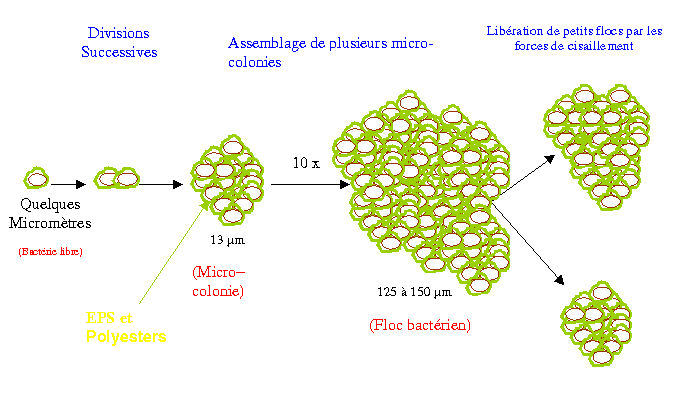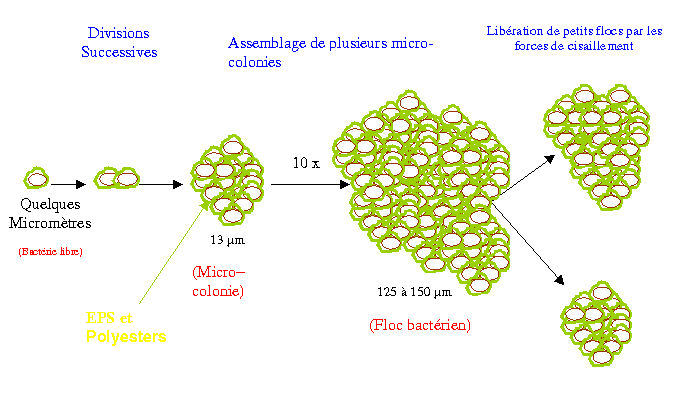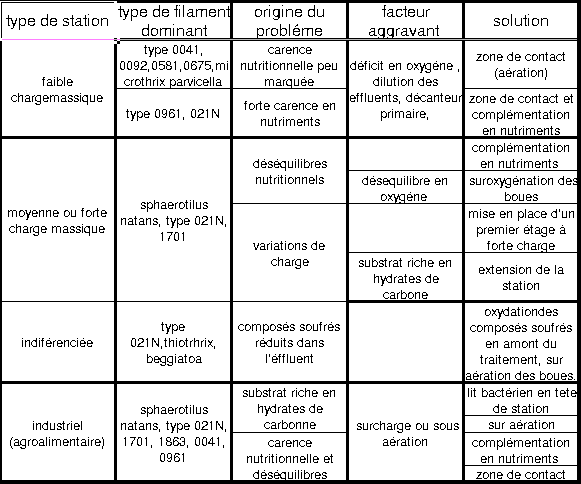DYSFONCTIONNEMENT DES STATIONS
D'EPURATION BIOLOGIQUE
Guillaume CAILLEUX (*)
4.5 Les moyens curatifs
4.5.1 Contre les filamenteuses
La
méthode la plus durable pour éviter les bactéries
filamenteuses est bien sur de déterminer la cause de leur explosion.
Cependant il n'est pas toujours aisé de savoir quel est le facteur
responsable, d'autant que, bien souvent, plusieurs facteurs se combinent.
Une fois la source du trouble localisée il n'est pas toujours facile
d'y trouver un remède à un coût acceptable. A cause
de ces limites technico-économiques il est assez fréquent
de soigner les effets plutôt que les causes. Deux techniques sont
couramment utilisées, elles font appel soit à des agents
toxiques (chlore et dérivés), soit à des agents floculants
(sels de fer, chaux, ou autre floculants industriels ?).
4.5.1.1La chloration
La
chloration est la méthode la plus efficace pour faire face aux situations
de crise ou repartir sur des bases biologiques assainies. Il semble que
de bons résultats soient obtenus à condition d'effectuer
le traitement pendant au moins un âge de boues, toutefois si les
causes ne sont pas supprimées les filamenteuses réapparaîtront
au bout de quelques semaines. Le chlore permet de détruire les organismes
vivants, tels que les organismes filamenteux, gênant une bonne décantabilité
des boues. Les filaments sont à la fois dans le liquide interstitiel
et dans les flocs, ceux présents dans le liquide interstitiel sont
très vulnérables vis à vis d'un oxydant. Par contre,
les filaments cachés dans le floc sont moins touchés lors
de la chloration et sont parfois à l'origine d'un réensemencement
ultérieur. Les bords anguleux des flocs sont eux aussi attaqués,
ils deviennent blanchâtres avant de disparaître. On observe
la mort simultanée d'un grand nombre de protozoaires libres. La
chloration doit donc être contrôlée et appliquée
à des doses maîtrisées, sous peine de mettre hors service
tous les micro-organismes réunis pour la dégradation de l'eau
usée.
Le chlore utilisé est, en général, celui de l'eau
de javel du commerce à 48° chlorométriques, donc sous
forme liquide. Il est admis que le dosage doit être compris entre
2 et 6 g de Cl2.kg-1 de MeS.j-1. La dose
ne doit pas dépasser 15 g de Cl2.kg-1 de MeS.j-1.
Le nombre de points d'injection doit être multiplié pour rester
dans une fourchette de concentration locale entre 4 et 20 mg de Cl2.l-1.
Au point d'injection l'agitation doit être maximale. Généralement,
l'ajout de chlore s'effectue au débouché des conduites de
recirculation, ou dans les dispositifs entre les bassins (s'ils existent),
voire directement dans le bassin d'aération. Habituellement on arrête
la chloration dés que l'indice de boue chute en dessous de 200 mg.l-1.
Souvent les effets du chlore se manifestent avec retard par rapport à
l'injection. Il faut être prudent dans l'accroissement des doses
mises en ?uvre, et ne modifier les réglages qu'avec un pas de temps
supérieur ou égal à deux jours.
4.5.1.2Les agents floculants (Sels de fer et d'aluminium)
Ils
ont une triple utilité. Ce sont des coagulants qui déchargent
électriquement les colloïdes donc permettent de rapprocher
les particules et favorisent la décantation. Ils précipitent
les phosphates et les sulfures dans les boues. En bloquant les sulfures
de l'effluent brut ou des boues en anaérobiose, ces réactifs
suppriment le substrat préférentiel de certaines bactéries
filamenteuses (Thiotrix). Il se pourrait aussi qu'agissant sur la
disponibilité du phosphore, les réactifs affectent le métabolisme
et diminuent ainsi la résistance des bactéries filamenteuses
à certains stress.
Le fer a des effets inhibiteurs sur Sphaerotilus et sur les types
0041, 1701, 0961, 1863 mais ne semble pas avoir d'effet sur
Microthrix,
Nocardia, Haliscomenobacter ni sur le type 0092.
4.5.1.3Le cas particulier des biolfiltres
Dans
le cas des biolfiltres, on peut éviter le foisonnement en provoquant
fréquemment un puissant lavage du matériau support. Le biofilm
est décroché avec les filaments précurseurs dont la
taille est d'ailleurs en équilibre avec la vitesse et la turbulence
de l'eau qui les entoure.
4.5.2Eviter les mousses physico-chimiques et biologiques par les floculants.
Le
moussage est favorisé par l'accumulation dans le réacteur
biologique d'acides gras volatils ainsi que par la production de produits
tensioactifs. L'ajout d'additifs chimiques du commerce agissant sur les
tensioactifs par précipitation des colloïdes et des lipides
saponifiés empêche la formation de la mousse. Leurs modes
d'action complexes sont toutefois rarement communiqués par les producteurs,
des essais préalables sont nécessaires pour choisir celui
qui convient le mieux. En vertu de son coût élevé ce
traitement ne sera appliqué qu'à des situations très
particulières ou en dernier recours (mise en service de nouvelle
installations, traitement forte charge, apports importants en produits
industriels tensioactifs?).
4.5.3Contre l'hydrogène sulfuré
La
présence de H2S au niveau d'une station est révélateur
d'une zone d'anoxie dans le réseau d'assainissement ou dans la station
elle-même. Nous l'avons vu, cette substance est très corrosive
pour le génie civil et très dangereuse pour les hommes, c'est
pourquoi il est intéressant de trouver une solution éliminant
ces gaz directement au niveau des canalisations. La technique utilisée
est l'injection d'oxygène dans l'effluent au niveau des postes de
relevage lorsqu'ils existent. Si l'injection dans le réseau n'est
pas techniquement possible, il faut employer des oxydants (tel que le chlorure
ferrique ou l'eau oxygénée) qui ont pour effet d'oxyder H2S
en H2SO42-. Cette solution peut aussi
être utilisée pour contrer des filaments tels que
Thiothrix
ou le type 021 N.
4.6 Les actions préventives
4.6.1Eviter les toxiques.
Les
flocons normaux ont une dimension de vingt à deux cents micromètres
et sont très hydrophiles. Si une eau ne forme pas de flocons, elle
est dite en «croissance dispersée». Dans certains cas
les flocons existent mais sont très petits, ils sont dits «
pint of flocs » ou «en tête d'épingle».
Ces
différents états peuvent avoir des causes diverses:
Concentration
en micro-organismes trop faible.
Eaux
trop pauvres ne permettant pas un développement suffisant des bactéries.
Présence
de métaux lourds (mercure, cadmium, zinc)
Présence
de peroxydes qui peuvent entraîner une défloculation partielle,
voire totale, de la boue.
Pour
remédier à de tels accidents, des chercheurs se sont demandés
s'il était possible de protéger les bactéries floculantes
en les dotant de gènes de résistance aux métaux. Une
équipe de Metz
a ensemencé de la boue avec une souche d'Alcaligenes eutrophus
résistante aux métaux lourds. Le but était de voir
si les gènes de résistance, localisés sur le plasmide,
se transmettaient spontanément aux bactéries sensibles, malheureusement
les résultats se sont révélés négatifs.
Actuellement aucun moyen n'a été trouvé pour éviter
les dégâts provoqués par l'action de produits toxiques
sur les flocs. Le seul moyen de s'en prémunir est de leur interdire
l'accès au réacteur biologique. Les grosses stations d'épuration
qui fonctionnent sur plusieurs files de traitement parallèles peuvent
se permettre d'en « sacrifier » une, qui servira de stockage
si le toxique est détecté à temps. Une méthode
consistant à créer un bassin de rétention aval peut
parfois aussi être envisagée. Ces solutions restent coûteuses
et sans grands résultats face au caractère imprévisible
(et souvent nocturne) des rejets toxiques.
Pour
se protéger du sel, les collectivités situées en bordure
de mer doivent mettre en place un système de collecte séparatif,
qui se justifie ici encore plus qu'ailleurs. Les eaux de débordement
de la mer, ne se jetteront plus dans les bassins ce qui permettra d'éviter
tous les tracas dus à une trop forte salinité. S'il n'existe
pas de réseau séparatif il est impératif de surveiller
le niveau de la mer (en cas de grosses marées ou de tempêtes)
pour le cas échéant by-passer la station. C'est une solution
qui doit, bien entendu, rester exceptionnelle, mais qui peut se concevoir
dans certains cas, il vaut mieux neutraliser la station une journée
que la laisser hors d'usage pendant plusieurs jours.
4.6.2Comment éviter les filamenteuses
Pour
tenter d'y voir plus clair sur la structure des flocs,
le CIRCEE associé à plusieurs laboratoires français,
a commencé par les fragmenter au moyen d'ultrasons. Ce travail a
permis d'étudier le mécanisme de formation des édifices
biologiques (Figure 22). Il a montré que les bactéries, d'une
taille de quelques micromètres, constituent, par mitoses successives,
des micro-colonies circulaires d'un diamètre moyen de treize micromètres.
Lors de l'étape suivante, plusieurs micro-colonies s'assemblent,
sous l'influence de facteurs physiques, pour former un floc d'environ cent
vingt cinq micromètres de diamètre.
Dans
un réacteur de station, la taille des flocs se stabilisera par cisaillement
des structures de brassage qui libéreront de petits flocs menant
une vie autonome. Les différences de taille entre les flocs entraînent
une différence dans la distribution des micro-organismes qui les
constituent.
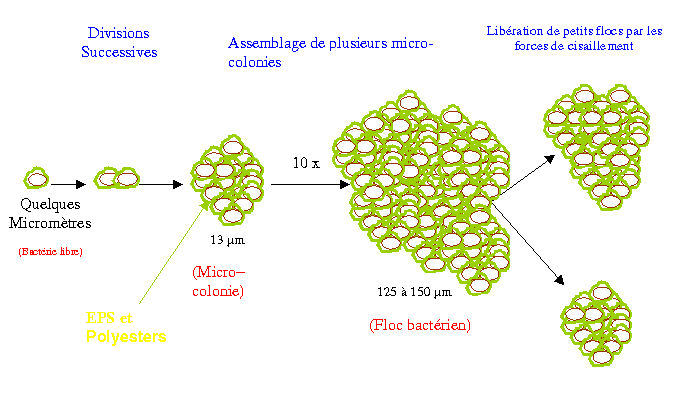
Figure
22 Formation d'un floc bactérien.
Sur
les grands flocs, les organismes eucaryotes, tels que les Protozoaires
Peritriches coloniaux (Epistylis, Carchesium, Opercularia, Zoothamnium),
sont accrochés vigoureusement, ils s'agglomèrent, se coagulent
et renforcent la solidité de l'édifice en augmentant et stabilisant
sa taille. Sur les petits, une autre faune spécifique colonise la
surface, on note en particulier la présence de petits zooflagellés
tels que Plueromonas jaculans. D'un réacteur à l'autre,
la taille du floc peut aussi dépendre des espèces bactériennes
qui le composent. La production d'exopolyméres varie, en nature
et en nombre, en fonction de l'espèce. Si l'exopolymère est
puissant les amas cellulaires seront gros et résisteront mieux aux
forces de dispersion. Les études du CIRCEE ont aussi permis d'avancer
des hypothèses sur le rôle de l'agglomération. Il semblerait
en effet, que cette structure ait une triple fonction, à la fois
de défense contre les prédateurs, de stockage d'éléments
nutritifs à l'intérieur du floc, et d'exploitation optimale
du milieu par les différentes espèces .
Le
Tableau 3 suivant nous donne la correspondance entre la nature du filament
observé (par la clé de détermination d'EIKELBOOM),
l'origine supposée du problème et les remèdes possibles.
Plusieurs
solutions peuvent être envisagées.
4.6.2.1Créer une zone de contact.
Les
matières en suspension améliorent la structure et la cohésion
du floc qui décante alors plus facilement. L'accessibilité
du substrat est meilleure et sa disponibilité augmentée pour
les organismes du floc. Une enquête, menée en 1982 en RFA,
a montré que 70% des stations équipées d'un décanteur
primaire étaient sensibles au foisonnement.
La tendance actuelle est donc à éliminer ce décanteur
primaire. De manière à améliorer encore ce phénomène,
des techniques, dites de zone de contact on étés mises
au point. Ce procédé vise à créer une augmentation
locale de la concentration en substrat. Dans le schéma classique
d'une station d'épuration à boues activées, le bassin
d'aération est en permanence brassé pour homogénéiser
parfaitement le milieu. Finalement les concentrations présentes
sont très proches des concentrations de rejet après décantation.
La
technique de la zone de contact consiste à faciliter la capture
du substrat assimilable par les germes non filamenteux avant l'introduction
des eaux résiduaires dans le bassin d'aération. Cette disposition,
qui vise à recharger en nourriture le voisinage du floc, est déterminante
dans la compétition entre formes floculantes et
formes
filamenteuses. Par cet artifice technique les germes floculants (dont la
capacité et la vitesse de capture du substrat sont supérieures
à celles des germes filamenteux) seront avantagés. Ceci se
traduit par une augmentation de leur taux de croissance. Dans la pratique
on réalise le mélange de boues et d'eaux résiduaires
dans des proportions définies lors d'essais préalables.
Ce mélange est effectué dans un bassin en amont du bassin
d'aération. Le temps de séjour doit y être bref (de
l'ordre de quinze minutes). Il se déverse ensuite dans un bassin
aéré où les concentrations en substrat et en nutriments
sont plus faibles.
On
peut aussi modifier le bassin d'aération pour en faire un bassin
à écoulement piston (bassin compartimenté)
ce système permet de créer un gradient des nutriments. A
l'endroit de la réinjection des boues la concentration favorise
le développement des bactéries floculantes. Il n'y a pas
de mélange du bassin en longueur, l'écoulement s'effectue
par gravité.
4.6.2.2Adapter l'oxygénation
Il
est important d'avoir une bonne oxygénation, car le manque d'oxygène
est souvent un facteur aggravant pour le foisonnement. S'il est relativement
facile d'ajuster la teneur globale en oxygène dans le bassin, (il
suffit d'agir sur quelques vannes pour augmenter ou diminuer le débit
d'oxygène), il est plus difficile de détecter des zones d'anoxie
locale. Il est important de pouvoir détecter ces zones où
les aérateurs sont défectueux et les remettre en état.
Des études ont été menées pour perfectionner
le système d'aération. Pour être le plus efficace les
bulles doivent avoir un rapport surface/volume le plus important possible,
il faut donc produire de très petites bulles, car plus elles sont
petites plus le rapport est important. Pour remédier aux problèmes
de colmatage des diffuseurs classiques, ce sont maintenant des diffuseurs
avec une membrane hémiperméable qui sont mis en place. Lorsque
l'aération est arrêtée, l'impossibilité de retour
d'eau dans les canalisations d'adduction d'air limite les risques.
4.6.2.3Apporter des Compléments en nutriments
La
concentration en nutriments pris séparément, n'a que peu
d'influence sur le foisonnement, c'est le déséquilibre DCO-Azote-Phosphore
qui entraîne la prédominance de certains germes filamenteux.
Il convient parfois de rajouter de l'azote ou du phosphore, de façon
à ne pas avoir des doses, d'azote organique total et de phosphore
total, inférieures,respectivement, à cinq unités et
une unité pour cent unités de DBO. Il peut également
y avoir foisonnement alors que l'effluent est apparemment équilibré
en azote, c'est le cas des stations recevant des eaux de brasserie ou de
l'industrie du poisson. L'azote y est effectivement présent en proportion
suffisante mais sous forme difficilement assimilable, il convient alors
d'apporter de l'azote organique facilement assimilable (urée, acides
aminés).
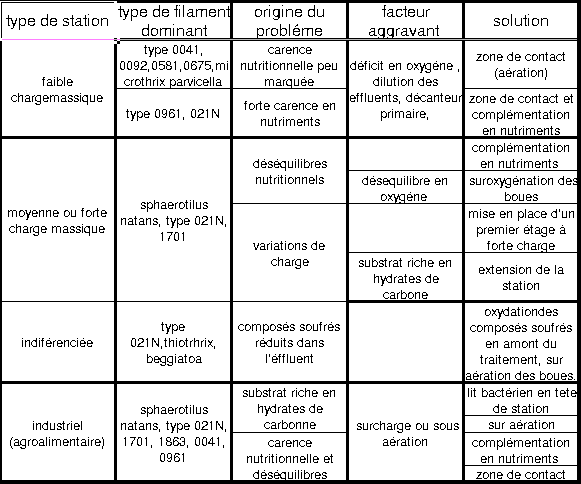
Tableau
3 Grille de correspondance type de filament / origines / remèdes
6 Conclusion
Les
méthodes d'épuration biologique sont des solutions bien adaptées
pour traiter un effluent urbain essentiellement chargé de matières
organiques, azote et phosphore. Quel que soit le procédé
choisi il reste d'un coût d'exploitation plus fable que les procédés
chimiques et présente ,en plus, le gros avantage de ne pas nécessiter
d'apport de réactif. Cependant les microorganismes sont très
dépendants du milieu dans lequel ils se développent. Les
variations des caractéristiques physico-chimiques de l'effluent
entraînent une modification de la faune qui s'y développe
et donc de la qualité de l'eau rejetée dans le milieu. Pendant
longtemps les gérants de station vivaient assez bien avec cette
variabilité. Aujourd'hui les lois imposent des rejets de plus en
plus strictes (loi sur l'eau N°92-3) et ce n'est certainement pas avec
la nouvelle loi sur l'eau, qui est attendue avec impatience par les professionnels,
que les choses vont s'assouplir. La gestion des stations biologiques est
donc de plus en plus une histoire de professionnels compétents et
qualifiés, capables de réagir rapidement face à un
incident biologique et de mettre en place les solutions adéquates.
Pour s'affranchir durablement de ces incidents il est important, dans la
mesure du possible, d'agir dès la conception de la station. Le choix
de la méthode ne doit pas s'effectuer uniquement sur des considérations
techniques, il est important de prendre en compte les performance du système
par rapport à la qualité de l'influent. Lorsqu'une station
en place est en proie à des incidents biologiques de façon
chronique, on peut envisager de modifier la conception de la station. Parfois
de petits aménagements peuvent suffire à régler le
problème et permettre un rejet d'eau épurée, de bonne
qualité. Des systèmes plus sophistiqués ont aussi
été imaginés tel que l'ensemencement avec des souches
de bactéries génétiquement modifiées ou la
mise au point de méthodes de filtration. Ces techniques séduisantes,
restent mal maîtrisées dans le domaine de l'épuration,
mais devraient se développer dans les années à venir.
Bibliographie
AGENCE
DE L'EAU. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
«
L'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS : techniques d'épuration actuelles
et évolution »
1994
AUBRIOT
Anne
FACULTE
DES SCIENCES DE REIMS
AGENCE
DE L'EAU SEINE NORMANDIE DIRECTION VALLEES DE MARNE.
«
ESSAIS D'APPROCHE DES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LES BACTERIES EPURATRICES
REJETTEES DANS LE MILIEU NATUREL »
1992
CANLER
J.P. PERRET J.M DUCHENE .P COTTEUX.E
«
Aide au diagnostic des stations d'épuration par l'observation microscopique
des boues activées »
éditions
du Cemagref
1999
CENTRE
NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE DU GENIE AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES
EAUX ET DES FORETS.
Etudes
du CEMAGREF Hors Série n° 4
«
MISE AU POINT SUR LE FOISONNEMENT DES BOUES. Techniques actuelles de lutte
»
1982
CENTRE
TECHNIQUE DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS
«
LAGUNAGE NATUREL AERE : procédés d'épuration des petites
collectivités »
1979
CONSEIL
GENERAL DE LA SOMME
AGENCE
DE L'EAU ARTOIS PICARDIE
«
AMELIORATION DU TRAITEMENT DE L'AZOTE DES EFLLUENTS »
1989
DEGREMONT
«
MEMENTO TECHNIQUE DE L'EAU » 9éme édition
1989
DRAKIDES
C.
Université
de Montpellier II
«
µicro-F
Diagnostic »
DUCHENE
P. PUJOL R. PAYRAUDEAU M. HYVRARD N. HUMBEY M.P. CAPELLIER M. LARIGAUDERIE
A. BARILLOT L. TURGIS R. TROUSSELLE C.
CEMAGREF
- A.R. - CISE - LYONNAISE DES EAUX - DUMEZ - S.A.U.R. - S.D.E.I. - SOGAEA
«
GUIDE CONTRE LES MOUSSES BIOLOGIQUES STABLES DANS LES STATIONS D'EPURATION
A BOUES ACTIVEES »
1993
DUHAMEL
B.
ENGREF
, OFFICE INTERNETIONALE DE L'EAU.
«
LES BACTERIES FILAMENTEUSES DANS LE TRAITEMENT PAR BOUES ACTIVEE »
Mars
1998
EDDLINE
F.
«
L'EPURATION BIOLOGIQUE DES EAUX : théorie et technologie des réacteurs
» 4éme édition
Edition
Cebedeau
1997
LAPRENT
J.P. LAPORENT-GOUGAUT M.
«
MEMENTHO TECHNIQUE DE MICROBIOLOGIE »
Editions
Lavoisier
1990
LAPRENT-GOURGAUT
M. SANGLIER J.J.
«
Biotechnologies : principes et méthodes »
Edition
Doin
1992
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
«
ELIMINATION DE L'AZOTE DANS LES STATIONS D'EPURATION BIOLOGIQUES DES PETITES
COLLECTIVITES »
1990
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
FOND
NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU
«
GUIDE TECHNIQUE SUR LE FOISONNEMENT DES BOUES ACTIVEES »
1991
MINISTERE
DE L'ENVIRONNEMENT. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, CEMAGREF
«
La maîtrise du foisonnement des boues par la technique de la zone
de contact »
1994
MINISTERE
DE L'ENVIRONNEMENT. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, CEMAGREF
«
Le foisonnement des boues activées : situation du problème
en France »
1988
MINISTERE
DE L'ENVIRONNEMENT. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, CEMAGREF
«
Prévention des dysfonctionnements biologiques en boues activées
»
1995
MINISTERE
DE LA RECHERCHE, MINISTERE DE L'AGRICULTURE
«
LES ELEMENTS LES PLUS SIGNIFICATIFS DE LA MICROFAUNE DES BOUES ACTIVEES
»
1993
MOLETA
R.
BIOFUTURE
165
«
Une carte d'identité moléculaire pour les microéboueurs
»
Mars
1997
PEIGNEN
P. MANEN J.
BIOFUTURE
178
«
Des bactéries épuratrices »
Mai
1998
PRESCOTT
; HARLEY ; KLEIN
"MICROBIOLOGIE"
Edition
De Boek
1995
PUJOL
R. VIRLOGET F. LARIGAUDERIE A. NAULEAU F. CANLER J.P. TROUSSELLE C. HALLOUIN
J.H.BARILLOT L. TURGIS R. DUCHENE P.
«
DYSFONCTIONNEMENTS BIOLOGIQUES DANS LES STATIONS D'EPURATION EN BOUES ACTIVEES
»
Actes
du colloque POLUTEC 94
1994
RIDEAU
J.P. DRAKIDES C. CASTEIGNAU G. CHAZELON J.C.
MINISTERE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE FONDATION
DE L'EAU
«
Prévenir Diagnostiquer Supprimer les pertes de boues dans les stations
d'épuration »
Mai
1980
SCRIBAN
R.
«
BIOTECHNOLOGIE 4éme édition
Technique
et documentation »
1993
VERDY
B.
Agence
de l'eau Seine-Normandie
«
LES BIOMASSES EPURATRICES »
1996
ZANELLI
F. ROBERT C.
ANJOU
RECHERCHE. AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE
«
INDICATEURs BACTERIENS DE L'EFFICACITE DES TRAITEMENTS OXYDATIFS »
1998